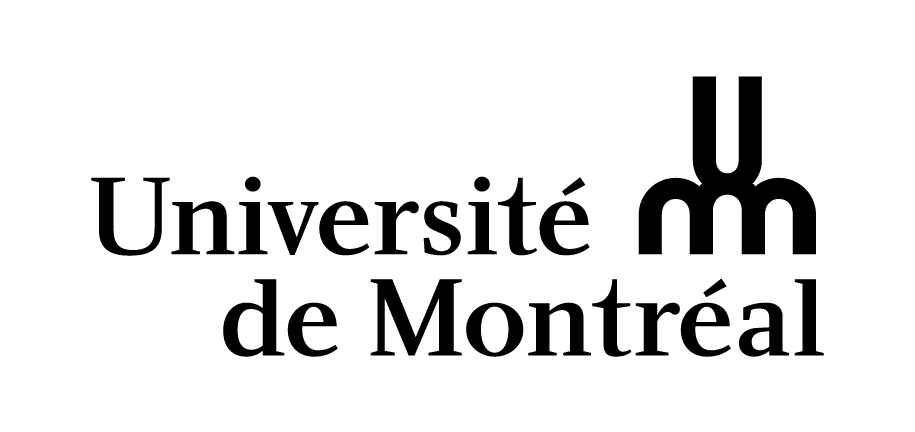Études médicales postdoctorales
|
Programme d'études
6-470-1-2
Durant le programme de formation d’une durée de 6 ans, la résidente ou le résident s’initie à plusieurs spécialités médicales et chirurgicales dont la neurologie clinique, la cardiologie, la chirurgie générale, la chirurgie carotidienne, la microbiologie, la neuropathologie et la neuroradiologie.
Sommaire et particularités
Information sur le programme
Admission
Information sur l'admission
Survol du programme
À propos
Développez vos compétences en neurochirurgie
La neurochirurgie est la spécialité qui voit au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies et des troubles médicaux du système nerveux, tant dans le cerveau que dans la région de la colonne vertébrale et des nerfs périphériques.
La résidente ou le résident effectue des stages à option, des stages de recherche en traumatologie crânienne et rachidienne, neurochirurgie pédiatrique et neurochirurgie adulte. La résidente ou le résident est exposé de façon précoce au travail chirurgical en salle d’opération.
À la fin de la formation, la résidente ou le résident aura acquis les connaissances et habiletés techniques requises pour pratiquer la neurochirurgie de façon autonome.
- Le programme de neurochirurgie de l'Université de Montréal est un programme de formation post-doctoral d'une durée de 6 ans.
- La durée du programme de formation n'excède pas les standards du Collège royal ou du Collège des médecins de famille du Canada.
- Un seul résident est admis à chaque 2 ans. Le programme de neurochirurgie a fait la transition vers le curriculum de la compétence par conception.
- Au cours de sa formation, la résidente ou le résident sera exposé de manière progressive aux différentes pathologies neurochirurgicales.
- Au terme de sa formation, l'apprenante ou l'apprenant sera en mesure de pratiquer de manière autonome la neurochirurgie et de compléter ses examens de certification du collège royal.
- Les premiers mois de formations sont complétés dans le programme des fondements chirurgicaux (également en approche par compétence) et par la suite, l'entrée dans le programme de neurochirurgie.
- Au cours de sa formation, la résidente ou le résident devra compléter l'examen des sciences de base des fondements chirurgicaux (R2), l'examen écrit du collège royal en neurochirurgie (R5) et l'examen oral du collège royal de neurochirurgie (R6).
- Un programme de maîtrise en sciences neurologiques et un programme de Ph.D. sont offerts à tous les résidents qui le désirent.
- Ces recherches peuvent être effectuées dans plusieurs domaines dont les sciences fondamentales, la biologie moléculaire, l'oncologie, l'épilepsie, les pathologies vasculaires, le rachis, l'épidémiologie et la recherche clinique.
- Le cheminement de la résidente ou du résident peut être modifié au besoin pour faciliter la recherche.
- Tous les résidentes et résidents sont exposés à des opportunités de recherche.
La mission globale du programme de formation en neurochirurgie à l'Université de Montréal est d'offrir l'ensemble des expériences requises, tant au point de vue technique, clinique, relationnel et humain, pour former des neurochirurgiens compétents qui auront à cœur la prise en charge de leurs patients dans leur communauté. Au terme de leur formation, les résidents pourront décider d'élargir leur pratique à des sous-spécialités neurochirurgicales de pointes, faire de la recherche ou pratiquer dans dans centres plus communautaires. Le programme de formation en neurochirurgie de l'Université de Montréal est d'une durée de 6 ans. Les 2 premières années forment le tronc commun. 1re année de résidence- 4 périodes en médecine (cardiologie, microbiologie, neurologie)
- 1 période de boot camp des fondements chirurgicaux
- 1 période de chirurgie générale (stage de nuit)
- 1 période de chirurgie générale (exposition initiale au trauma)
- 1 période de chirurgie digestive
- 2 périodes en neurochirurgie adulte
- 1 période de soins critiques
- 1 période de stage à options (recherche, chirurgie vasculaire, ORL, plastie, neuro-oncologie...)
2e année de résidence- 2 périodes en soins critiques (dont 1 stage de nuit)
- 4 périodes en neurochirurgie adulte
- 7 périodes de stage à options (recherche, chirurgie vasculaire, ORL, plastie, neuro-oncologie
3e année de résidence- 2 périodes en neurologie
- 8 périodes en neurochirurgie adulte (dont 3 périodes peuvent être prise pour de la recherche)
- 3 périodes de neurochirurgie / neurotraumatologie adulte
4e année de résidence- 3 périodes en neuro-radiologie
- 10 périodes en neurochirurgie adulte
- Traumatologie crânienne et rachidienne (Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal)
5e année de résidence- 2 périodes en chirurgie du rachis traumatique,
- 1 période en neurochirurgie / neurotraumatologie adulte
- 4 périodes en neurochirurgie pédiatrique
- 6 périodes en neurochirurgie adulte
6e année de résidence- 8 périodes en neurochirurgie adulte
- 3 périodes en neuropathologie
- 1 période en nerfs périphérique
- 1 période en chirurgie de la carotide
Stages à option - Tronc commun (première et deuxième année) : chirurgie plastique, chirurgie vasculaire, neuro-ophtalmologie, orthopédie, ORL, recherche
- 5e année : chirurgie vasculaire, endovasculaire et maxillofaciale, neurochirurgie communautaire (non universitaire), neurochirurgie pédiatrique, neurochirurgie adulte surspécialisée, neuro-ophtalmologie, neuro-otologie, ORL, radiochirurgie
Programme d’enseignement formel : - une demi-journée hebdomadaire universitaire
- cycle de deux ans
Les résidentes et résidents sont exposés de façon progressive aux pathologies chirurgicales. Nous insistons pour l'exposition précoce en salle d'opération. Les résidentes et résidents sont aussi exposés aux consultations à l'urgence, aux cliniques externes ainsi qu'aux soins des patients aux étages. L'enseignement formel est favorisé par la demi-journée pédagogique hebdomadaire. Lors de cette demi-journée pédagogique les résidentes et résidents sont exposés à des cours qui couvrent l'ensemble des domaines de la neurochirurgie. Ces cours sont donnés par les membres du corps professoral, des professeurs invités et les résidents. Ont également lieu lors de cette demi-journée pédagogique des clubs de lecture, des séminaires, des réunions de morbidités et mortalités. Deux fois par année, un examen écrit formatif traitant des sujets couverts par la demi-journée académique est réalisé. Il y a aussi de façon périodique des examens oraux formatifs pour préparer les résidents aux examens du Collège royal. Un laboratoire de microchirurgie est utilisé pour l'apprentissage technique sur des modèles cadavérique. Méthodes d’évaluation- Fiche d’évaluation formelle
- Examens oraux formatifs
- Examens écrits formatifs
- Examen écrit annuel de neuropathologie durant les deux dernières années de formation
- Examen écrit canadien formatif, annuel, de la troisième à la sixième année
- Occasions propices à l’apprentissage (OPA)
Centres de formation- Hôpital Notre-Dame du CHUM
- Centre Hospitalier Universitaire Ste-Justine
- Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
6 périodes de stage optionnel sont accordées à chaque résident pour la réalisation d’un projet de recherche. La plupart des résidents feront une maîtrise (M. Sc.) en sciences neurologiques. Les résidentes et résidents qui ont un projet de recherche en cours peuvent utiliser un lendemain de garde où ils n’ont pas travaillé la nuit pour faire progresser leur projet. Ils peuvent aussi prendre une journée, occasionnellement, pour avancer dans un projet. La résidence peut être interrompue pendant deux ans pour réaliser un doctorat en sciences neurologiques ou dans un autre domaine lié au système nerveux ou à l’enseignement. Une résidence peut être interrompue durant six périodes pour terminer une maîtrise. Au cours de leur formation, en plus de la maîtrise, tous les résidentes et résidents participent à des travaux de recherche et publications d’envergure. Le directeur du programme et le chef de la division aident les résidents chercheurs à soumettre leur candidature à des bourses de divers organismes, dont l’Université de Montréal, le CHUM, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le Fonds de recherche du Québec – Santé et les Instituts de recherche en santé du Canada. La plupart des professeurs se servent de leurs fonds de recherche pour couvrir certaines dépenses des résidents en recherche. Pendant les périodes optionnelles de recherche, les résidents sont rémunérés par leur entente collective avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Tous les résidentes et résidents participent activement et régulièrement à des congrès provinciaux, nationaux et internationaux. Elles ou ils doivent prendre part à un minimum de deux congrès par année. Une aide financière est apportée à la résidente ou au résident pour se présenter individuellement à un congrès et si les ressources de la division le permettent. Tous les professeures et professeurs contribuent au financement de ces activités. La Dre Marie-Pierre Fournier-Gosselin, neurochirurgienne au CHUM, est responsable de la recherche. Cliniques spécialiséesIl existe des cliniques multidisciplinaires spécialisées dans les domaines suivants : épilepsie, troubles du mouvement, neuro-endocrinologie, neuro-oncologie, vasculaire, rachis, neurochirurgie pédiatrique, traumatologie crânienne, neuromodulation pour clientèle psychiatrique, douleur. Ceci permet aux résidents d'assister à des discussions sur les cas complexes et permet aussi d'initier le résident à la recherche multicentrique. Nombre de professeurs : 12 neurochirurgiens, soit 6 à l’Hôpital Notre-Dame du CHUM en neurochirurgie adulte, 2 au CHU Sainte-Justine en neurochirurgie pédiatrique et 4 à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal Types de fellowshipsSpécialités- Base du crâne
- Neurochirurgie de l’épilepsie
- Neurochirurgie oncologique
- Neurochirurgie pédiatrique
- Neurochirurgie rachidienne
- Neurochirurgie vasculaire
Conditions d’admissibilité
Assurez-vous de sélectionner vos choix pour afficher les conditions d’admissibilité qui s’appliquent à vous.
Conditions générales d’admissibilité
Pour être admissible à titre d’étudiant régulier et sous réserve de la qualité du dossier, le candidat doit soit :
satisfaire aux conditions générales d’admissibilité (section 5.3) du Règlement des études médicales postdoctorales; et respecter la règle sur l'éloignement de la pratique.
Règle sur l'éloignement de la pratique
Le candidat qui dépose une demande d’admission doit pouvoir démontrer à l’aide d’une documentation officielle qu’il a soit : - terminé sa formation médicale de 1er cycle (doctorat en médecine, M.D.) ;
- été en stage dans un programme de résidence ;
- pratiqué la médecine de façon autonome,
à l’intérieur des quatre années précédant la demande d’admission. La préférence sera accordée aux candidats qui pourront démontrer qu’ils ont eu une pratique clinique autonome, soutenue et continue sur une durée minimale d’une année au cours des deux années précédant la demande. À noter que les stages d’observation et la télémédecine ne sont pas considérés comme étant une pratique clinique autonome.
Adoptée par le Comité des études médicales postdoctorales (2022-CEMP-65-res01), 14 décembre 2022
Révisée le 12 juin 2024
Exigence de français à l’admission
Dans le cadre de sa mission de former des médecins compétents, la Faculté doit s’assurer de prendre les moyens nécessaires afin de préserver la sécurité des patients. Tout résident ou moniteur qui souhaite effectuer de la formation médicale postdoctorale à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, doit avoir une connaissance suffisante de la langue française. On définit un moniteur comme toute personne qui poursuit une formation médicale postdoctorale (résidence ou fellowship), en étant rémunéré par une source de financement autre que la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Afin de permettre à ces résidents ou moniteurs de s’adapter à leur nouveau milieu et à leur nouvel environnement francophone, le directeur de programme pourra autoriser le résident ou le moniteur à effectuer des stages non contributoires pendant les deux ou trois premiers mois de sa formation. À l’issue des trois premiers mois de sa formation, il pourrait être exigé du résident ou du moniteur, à la discrétion du vice-décanat aux études médicales postdoctorales, qu’il complète avec succès un examen de français. Si après cette période le directeur du programme constate que de laisser poursuivre la formation du résident ou du moniteur pourrait mettre en péril la sécurité des patients vu la non maîtrise du français, il pourra après discussion avec le vice-doyen des études médicales postdoctorales, enclencher le processus de recommandation d’abandon ou exclusion.
Exigences linguistiques
Une bonne maîtrise du français parlé et écrit est indispensable.
Moniteurs
Les candidats dont la langue maternelle n’est pas le français et qui ne répondent pas aux critères d’exemption ci-dessous doivent effectuer le test d’évaluation de français (TEF) ou équivalent.
Conditions - Le candidat doit s’inscrire et payer les frais requis directement auprès de l’organisme qui administre le test
- Le candidat sera invité à être évalué sur les 2 compétences suivantes : compréhension orale et compréhension écrite
- L’expression orale sera évaluée par le programme lors de l’entrevue
- Le résultat minimum requis par le vice-décanat aux études médicales postdoctorales pour une admission sans condition est le niveau B2
- Un candidat peut répéter le TEF afin d’améliorer son résultat
Exemptions
Sont exemptés de ce test, les candidats ayant effectué leurs études secondaires en français au Canada OU leurs études collégiales en français au Québec OU d’autres études préuniversitaires entièrement en français OU des études universitaires de 1er cycle entièrement en français.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'Outil d’aide à la décision.
Notez que les critères quantitatifs ci-dessus ne remplacent pas l’analyse qualitative de votre dossier. Ces critères sont publiés uniquement à titre indicatif. Une admissibilité à un programme d’études ne garantit pas une offre d’admission. Les informations contenues sur cette page sont modifiables sans préavis.
Tout savoir sur l’admissibilité à ce programme
Les conditions d’admission diffèrent selon votre statut et la formation que vous souhaitez suivre.
Consultez les informations complémentaires selon votre profil.
|